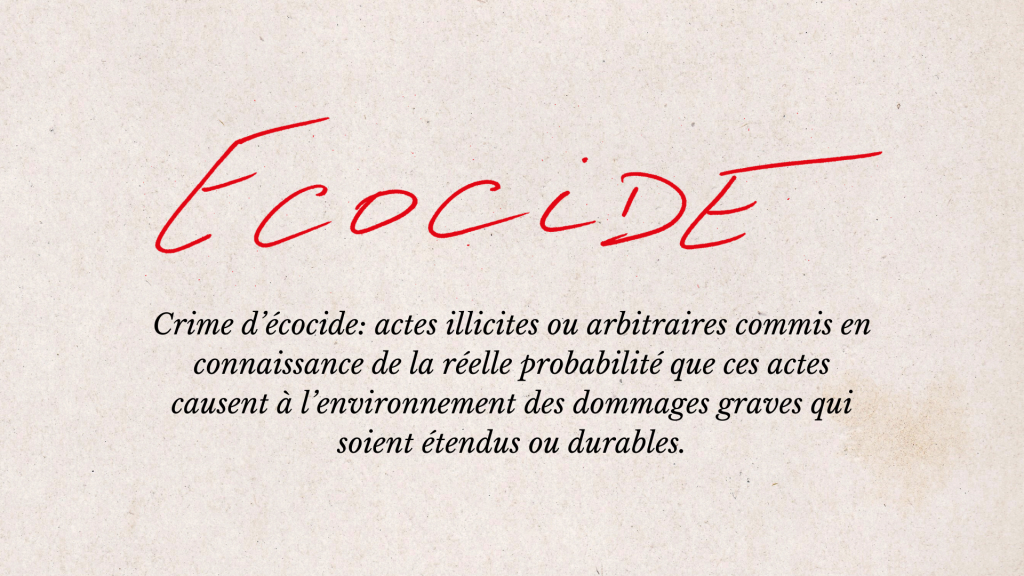Inscrire des principes écologiques à l’Article 1 de la Constitution serait une avancée certaine. Si le climat et la biodiversité devenaient des valeurs aussi fondamentales que l’égalité ou la liberté, la dignité ou le bien-être, cela signifierait concrètement que nous comprenons à quel point nos droits fondamentaux humains ne peuvent plus être garantis sans que les systèmes écologiques de la terre dont nous dépendons pour respirer, boire, manger, nous soigner soient préservés. Cela étant dit, réformer la Constitution, ne peut se faire « sans filtre ». L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du parlement. Cette révision doit être votée par les deux assemblées en termes identiques avant d’être définitivement approuvée par référendum. Le chemin à parcourir est encore long !
En revanche la mesure concernant l’adoption d’une loi reconnaissant le crime d’écocide peut être proposée par voie référendaire si elle est rédigée précisément. C’est ce qu’ont fait les citoyens en définissant le crime d’écocide, en imaginant ses modalités d’instruction et d’application. Cette loi permettrait de sanctionner les plus gros pollueurs qui agissent en connaissance des conséquences de leurs activités et font peser une menace sur la sûreté de la planète, sur les conditions d’existence des générations futures.
Enfin, créer une Haute Autorité aux limites planétaires permettrait la mise en oeuvre de politiques publiques respectant les grands équilibres écologiques. Il semble en effet que toutes ces mesures soient inspirées de mon plaidoyer en leur faveur lors de mon audition devant la CCC le 11 janvier dernier au Cese. J’ai défendu devant l’« escouade », groupe de travail transversal de la CCC, la nécessité d’adopter une Constitution écologique qui engage l’Etat à lutter contre le dérèglement climatique, à préserver la biodiversité, mais aussi à respecter les limites planétaires.
Le même jour, j’ai aussi été auditionnée par le groupe « Se nourrir » qui voulait connaître notre proposition de loi sur le crime d’écocide, présentée à des députés et des sénateurs en octobre 2019. Ce projet prévoyait, entre autres, la création d’une Haute Autorité aux limites planétaires. Les citoyens semblent avoir été convaincus puisque leurs mesures sont quasi-similaires aux nôtres. C’est extrêmement encourageant.
Ce qui l’est tout autant est la teneur d’un courrier par 55 député·es qui ont d’ores et déjà annoncé aux citoyens de la Convention soutenir leur travail et se disent prêt·es à prendre la suite… pour le concrétiser par la voie législative. Parmi ces députés, de nombreux parlementaires étaient avec nous en octobre dernier pour avancer sur le crime d’écocide. Il est heureux que les citoyens aient pu entre temps prendre toute leur place dans cette révolution juridique, consolidant par là nos effort communs.
De façon générale, ce qui me frappe aussi, est la manière dont ils ont su déborder de leur mandat initial. Ils ont rapidement compris la portée systémique de mes idées. Ils ont compris qu’une politique climatique ne pouvait se restreindre à la question des émissions de GES, qu’elle devait s’accompagner d’une politique globale respectueuse des autres limites planétaires.
Quelles sont-elles ?
Le changement climatique et l’érosion de la biosphère comportent, selon les scientifiques, des « limites fondamentales » qui interagissent entre elles. C’est le constat d’une équipe internationale de 26 chercheurs, menée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre et Will Steffen de l’Université nationale australienne, qui a identifié dès 2009 neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre. Ensemble, ils fournissent les conditions d’existence dont dépendent nos sociétés. Ils ont ensuite déterminé les seuils à ne pas franchir pour chacun d’entre eux afin d’éviter de basculer dans un état planétaire inhospitalier et dangereux.
Ainsi une grille de lecture est proposée concernant le taux d’émissions de CO2, le taux d’érosion de la biodiversité, mais aussi concernant la perturbation du cycle de l’azote et du phosphore, le seuil de déforestation, le taux d’acidification des océans, l’usage de l’eau douce.
Sont aussi prises en considération les problématiques liées à l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère et des entités nouvelles dans la biosphère.
Le franchissement de chacune de ces limites nous conduit vers un « point de basculement » caractérisé à la fin par un processus d’extinction irréversible d’espèces et des conséquences catastrophiques pour l’humanité. Quand la biosphère est endommagée, son érosion a un impact sur le climat. La couverture végétale et le sol n’assument plus leur rôle crucial de régulation climatique directe, outre de stockage et de recyclage du carbone. La déforestation entraîne la disparition locale définitive des nuages et des pluies. La perte de plancton marin enraye la pompe à carbone qu’est l’océan.
Cette grille de lecture, la France l’utilise déjà comme en témoigne le rapport sur l’état de l’environnement publié en octobre 2019 par le ministère de la Transition écologique. Il fait état du dépassement de six des neuf limites connues par notre pays. Mais si ces limites sont reconnues comme des outils de suivi des objectifs de développement durable, elles ne sont pas contraignantes.
Les citoyens l’ont bien compris et ont ainsi proposé d’inscrire dans notre droit le respect des limites planétaires afin de permettre aux institutions de notre État de cadrer les activités qui menacent le système terre. La reconnaissance des limites planétaires comme normes juridiques permettra au législateur mais aussi au juge d’apprécier la dangerosité d’une activité industrielle en s’appuyant sur les valeurs seuils déterminées par le Stockholm Resilience Center, et donc d’être en mesure d’apprécier si une activité industrielle est tolérable ou non.
Qu’en est-il de l’avancée de la notion de limites planétaires au niveau européen et international ?
Le « rapport sur l’état de l’environnement » de l’Agence européenne pour l’environnement rendu en 2010 hisse les limites planétaires au rang de « priorité environnementale ». Ce référentiel figure sur la feuille de route de l’Union européenne, et le Green deal va dans le bon sens, mais cela avance trop lentement. Des député.e.s européen.ne.s, comme Marie Toussaint, travaillent à leur reconnaissance comme normes juridiques. Elle oeuvre aussi à la reconnaissance du crime d’écocide et des droits des écosystèmes sur le sol européen. Mais la notion de limites planétaires est considérée comme portant atteinte à la liberté d’entreprendre. Il faut savoir que le droit commercial, qui s’est développé en dehors du droit international essentiellement dédié à la paix, a construit une réglementation très forte, capable de l’emporter face à des États.
A l’échelle internationale, Ban Ki Moon, alors secrétaire général des Nations Unies, a évoqué, lors de l’Assemblée générale de 2011, les limites planétaires comme outil de mesure scientifique. S’adressant aux dirigeants du monde, il a déclaré : « Aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux ». Le Groupe de haut niveau de l’ONU sur la viabilité du développement mondial (UN High-Level Panel on Global Sustainability) inclut alors la notion de limites planétaires dans son rapport de 2012 nommé « Pour l’avenir des hommes et de la planète: choisir la résilience ».
Que ce soit à l’échelle internationale ou à l’échelle française, j’essaie de faire en sorte que ces limites deviennent des normes. J’ai évoqué le sujet à l’ONU à New York lors de mon intervention durant le Jour international de la Terre le 22 avril 2019. Il me semble en effet impératif, vu l’urgence écologique et climatique, de définir et respecter ce plafond écologique. On ne peut se contenter de l’empreinte écologique individuelle comme compas, car une fois de plus cela fait peser une responsabilité sur les citoyens tout en dédouanant les gouvernements, les politiques publiques et les industriels de leurs responsabilités ; et il faut le normer de façon à ce qu’il devienne le nouveau cadre dans lequel l’activité humaine globale s’inscrit, et de façon plus particulière, l’activité industrielle.
Ces limites planétaires constituent aussi un outil qui pourrait être utile si un jour le crime d’écocide à l’échelle internationale était reconnu. On parle ici d’un crime international grave, un crime contre la paix et la sécurité humaine. C’est pourquoi il doit être instruit par la Cour pénale internationale (CPI) s’il était reconnu internationalement. Que ce soit en droit pénal national ou international, il me semble que les limites planétaires peuvent constituer un très bon outil de mesure pour déterminer la gravité d’une atteinte portée à un écosystème; d’autant qu’il n’existe pas de consensus, depuis très longtemps, sur ce que l’on appelle en droit des « dommages étendus, graves et durables » à l’environnement. Il existe plusieurs définitions. Celle des Conventions de Genève diffère de celle de la Convention ENMOD sur les armes chimiques.
La pandémie de Covid-19 a-t-elle permis un prendre un certain recul ?
Cette pandémie permet de prendre ce recul, par rapport au confinement et ce qu’il s’est passé partout dans le monde. On voit que ce sont les populations les plus pauvres qui sont les plus touchées. La crise actuelle aux Etats-Unis est en écho à ce qui s’est passé pendant le Covid, même si c’est une revendication qui trouve bien évidemment son terreau dans des décennies, voire des centaines d’années, de discrimination des populations afro-américaines. Mais le Covid a mis en lumière ces inégalités sociales. Une crise environnementale les révèle de manière encore plus criante.
Il y a eu une volonté de la part de la société civile, des penseurs, des philosophes, des sociologues, de ne pas trop attendre la sortie de la crise pour réitérer des demandes qui étaient en fait anciennes, en les remettant en perspective. Nous avons face à nous un signal très fort qui nous montre ce qui préfigure demain, avec les crises climatiques qui vont être de plus en plus graves, les migrations forcées, la sixième extinction des espèces, laquelle à un moment donné ou à un autre finira par menacer l’espèce humaine.
Une étude, publiée le 1er juin dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, explique que la sixième extinction de masse s’accélère et met en péril la survie de l’espèce humaine elle-même. « Lorsque l’humanité extermine d’autres créatures, elle coupe la branche sur laquelle elle est assise, détruisant des parties essentielles du système qui permet le maintien de la vie sur Terre », explique Paul Ehrlich, professeur à l’Université de Stanford, un des co-auteurs de l’étude. L’épidémie de Covid-19 est un exemple, selon les chercheurs de l’IPBES, de la manière dont l’érosion de la biodiversité et la destruction des habitats naturels peuvent menacer l’humanité.
Avec la récession économique qui se profile, on est tous très inquiets des choix que les gouvernements vont faire partout dans le monde en termes de relance. Organiseront-ils une relance qui prend en considération le risque climatique, écologique, profitant de cette crise pour repenser complètement le système ? C’est ce à quoi j’aspire, un peu dans la lignée de la théorie du beignet de Kate Raworth – the Donut theory – : une société qui garantisse les besoins fondamentaux de chacun.e, autrement dit un « plancher social » tout en acceptant, et c’est cela la nouveauté, de fonctionner avec un « plafond écologique » déterminé par les « limites planétaires », pierre angulaire de mon plaidoyer. Nous devons rompre avec l’obsession de la croissance qui est incompatible avec le principe de finitude propre à la vie. Cette idéologie économique nous conduit vers un avenir mortifère.
La crise provoquée par le Covid-19 pourrait-elle être une opportunité d’accélérer un changement de cap ? Avec quels leviers ?
En effet, cette crise nous révèle notre vulnérabilité et nos liens d’interdépendance avec le reste du vivant. Aujourd’hui encore, c’est l’économie qui prime sur l’homme, sur la nature et qui nous place dans une situation absolument intenable. Le Covid est une expression de l’écocide en cours. Une zoonose, c’est-à-dire une maladie qui se transmet d’un animal sauvage vertébré à un humain, ne peut se transmettre que quand les humains sont trop proches des espaces sauvages. La déforestation y contribue, tout comme l’urbanisation galopante.
Le Covid nous invite à un retour à l’essentiel, à la sobriété et à l’autonomie. Il me semble que l’échelle du territoire est idéale pour expérimenter de nouveaux modes de gouvernance et retisser du lien social, nécessaire à l’expression de la solidarité. Pendant le confinement, j’ai pu constater que le « monde d’après » était déjà en train de se construire à l’échelle locale. Il y a des réseaux de solidarité extraordinaires qui se sont mis en place pour penser et mettre en oeuvre une résilience, une souveraineté alimentaire, une économie relocalisée et une solidarité en action. Mais l’Etat doit en même temps être garant du respect global du plancher social et du plafond écologique. Et cette prise de conscience émerge aussi dans la population et rend davantage possible l’adoption de mesures innovantes mais aussi contraignantes.
Nous prenons conscience que nous ne sommes pas maîtres de la nature, que nous sommes interconnectés et que les règles du vivre-ensemble doivent maintenant prendre en considération les non-humains. Il y a une concordance de différents mouvements qui aspirent à un autre modèle de société, où pourrait entrer dans le débat démocratique des entités naturelles dont le rôle écologique est vital pour maintenir la sûreté de la planète pour tous.
C’est mon ultime plaidoyer : un renversement de l’échelle des normes où les droits de la nature seraient reconnus et défendus, les droits fondamentaux de l’humanité garantis par la préservation du vivant et au final où l’économie serait remise à sa juste place, au service de la régénération des écosystèmes et du bien-être humain. L’économie doit revenir à son sens étymologique premier : la bonne gestion de la maison commune. Il est donc très important que la société civile s’empare de toutes ces idées, continue à faire pression sur les gouvernements et les élus. Il convient aussi de continuer à sensibiliser les citoyens à ces questions d’écocide et de limites planétaires, d’autant plus si les mesures de la CCC rédigées sous forme de propositions de loi sont vouées à être adoptées par référendum.
Deux ouvrages collectifs auxquels vous avez participé viennent d’être publiés , « Ce qui dépend de nous. Manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire » (éd. LLL, coordonné par Attac) et « Résistons ensemble pour que renaissent des jours heureux » (éd. Massot, coordonné par le Conseil national de la Nouvelle Résistance) ? Qu’ont-ils en commun ?
Ils ont en commun la volonté d’aplanir à la fois les inégalités sociales et les inégalités environnementales et rejoignent en cela le mandat que s’est donné Notre Affaire à Tous, l’association que j’ai co-créée en 2015 avec Marie Toussaint. Pour nous, justice économique, sociale, climatique et environnementale sont indissociables. Notre Affaire à Tous s’inscrit dans un mouvement mondial, celui de la mobilisation pour pénaliser les crimes contre l’environnement, de l’action en justice pour le climat et les générations futures, mais aussi de la reconnaissance des droits de la nature.
Dans le monde entier, des citoyen.nes et des associations se tournent vers les tribunaux pour faire respecter leurs droits et ceux de la nature. Ils contestent le manque d’ambition des politiques des Etats et engagent la responsabilité des entreprises les plus polluantes.